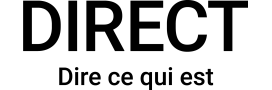La Suisse et l’Union européenne ont l’habitude de conclure des accords et des traités. De nouveaux accords, les « bilatérales III », ont été conclus. Leur contenu exact n’est pas encore public, car il doit être traduit en texte de loi avant d’être soumis à consultation.
Depuis la création de l’UE, 20 accords bilatéraux et plus de 100 accords régissent les relations entre la Suisse et l’UE. Dans les discussions sur les accords bilatéraux, on oublie souvent qu’ils sont étroitement liés aux progrès sociaux. Salaires minimums, protection des salaires, voyages sans contrôle aux frontières, mobilité des étudiant-es : sans les accords bilatéraux, ces mesures seraient impensables – et sans ces mesures, les accords bilatéraux n’existeraient pas.
Contre les salaires de dumping et le travail au noir : les mesures d’accompagnement
Entre 1994 et 1999, la Suisse et l’UE ont négocié les accords bilatéraux I. Un ensemble de sept accords couvrant différents secteurs, dont la recherche, les transports terrestres et l’agriculture, ainsi que la libre circulation des personnes.
À l’époque, les syndicats craignaient que cela n’entraîne dudumping salarial, une détérioration des conditions de travail et du travail au noir. Ils ont donc exigé des mesures nationales imposant des normes minimales pour les travailleur-euses en Suisse. Très tôt, le Conseil fédéral, l’Union patronale suisse et l’Union syndicale suisse ont commencé des négociations sur les mesures d’accompagnement.
Ces discussions ont toutefois été interrompues en raison de divergences d’opinions. Le Conseil fédéral a donc dû soumettre ses propres propositions au Parlement. Quelques-unes étaient controversées, notamment celle du dumping salarial : le Conseil des États s’est d’abord prononcé contre les syndicats sur ce point, mais a finalement suivi le compromis proposé par le Conseil national, plus favorable aux travailleur-euses.
Les parlementaires des cantons frontaliers, tels que les syndicalistes et conseillers nationaux socialistes Jean-Claude Rennwald (JU) et Paul Rechsteiner (SG), se sont particulièrement engagés en faveur d’une protection salariale forte. À l’époque, les socialistes et les Vert-es pouvaient également compter sur le soutien des démocrates-chrétiens et des libéraux sur ces questions.
« Grâce aux mesures d’accompagnement, on a pour la première fois disposé d’instruments — notamment des contrôles — pour lutter au plan local contre la sous-enchère salariale. Les salaires s’en sont trouvés améliorés », écrit rétrospectivement l’Union syndicale suisse. En effet, les mesures d’accompagnement permettent des contrôles salariaux annuels et systématiques. Ces contrôles ont contribué et contribuent encore à détecter les abus et à permettre des augmentations de salaire.
En cas de dumping salarial, il est désormais plus facile d’introduire des salaires minimaux : les dispositions relatives au salaire minimal figurant dans les conventions collectives de travail (CCT) peuvent être déclarées de force obligatoire générale. Les branches sans CCT peuvent en outre adopter des contrats-types de travail qui fixent un salaire minimal.
Le référendum contre les bilatérales II
Quelques années plus tard, le Conseil fédéral a renégocié avec l’UE : en 2004, la Suisse a signé le paquet de mesures des « Bilatérales II ». Celui-ci comprenait l’accord Schengen/Dublin, qui approfondissait la coopération avec l’UE dans les domaines de l’asile et de la sécurité. Les accords bilatéraux II comprenaient également des accords dans les domaines du tourisme et de la fraude fiscale.
L’UDC a lancé un référendum contre Schengen/Dublin, mais la population a dit oui aux accords en 2005. Bien que l’accord ait été controversé au sein de la gauche, le PS avait alors recommandé de voter oui. La raison : la Suisse ne pouvait pas s’isoler en Europe. De plus, les forces progressistes partaient du principe qu’une coopération européenne pourrait contrer la politique d’asile répressive de la Suisse. Cela a sans aucun doute été le cas pendant quelques années.
Cet ensemble d’accords régit également un acquis aujourd’hui considéré comme allant de soi : la libre circulation en Europe, que ce soit en tant que touriste, chercheur-euse ou étudiant-e.
Un rapport rédigé par le Département fédéral des affaires étrangères sur les avantages économiques de Schengen/Dublin, qui répond à un postulat du groupe socialiste aux Chambres fédérales, stipule que : « Les avantages de Schengen/Dublin vont au-delà des aspects purement financiers. »
Bilatérales III : poursuivre sur la voie du succès
Et aujourd’hui ? Alors que le néofascisme frappe aux portes de l’Europe, un regard sur le passé montre que l’UE était déjà considérée il y a vingt ans comme la partenaire la plus fiable de la Suisse. À l’époque déjà, la Suisse avait choisi l’ouverture plutôt que l’isolement.
En matière de protection des salaires notamment, les accords bilatéraux III promettent la poursuite d’une voie socialement acceptable. Reste à voir si le PLR et Le Centre soutiendront pleinement ces accords, ou s’ils chercheront à en atténuer la portée lors des débats parlementaires. Avec les bilatérales III, l’histoire à succès peut se poursuivre. Mais un tel projet n’a généralement de chances d’aboutir que s’il est accompagné de progrès sociaux.